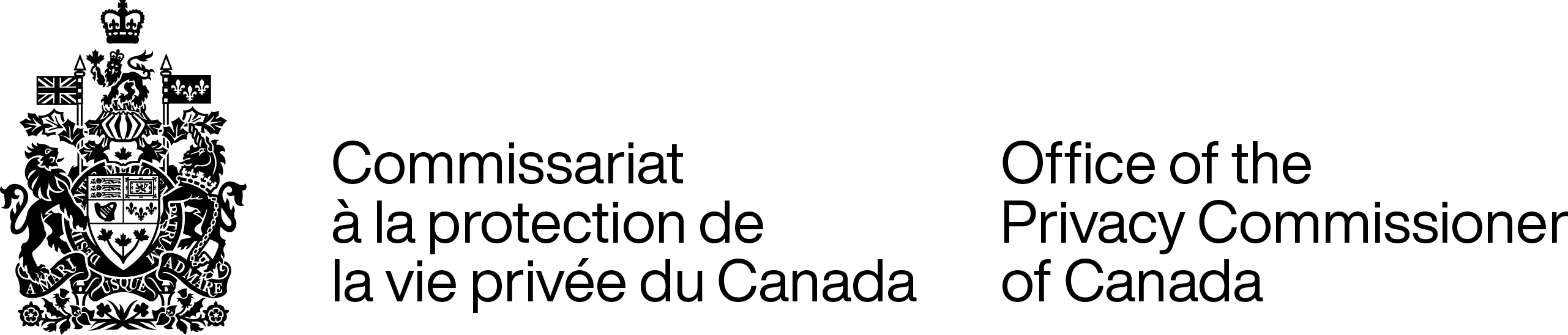La durée de vie (il)limitée des renseignements personnels à l’ère numérique
Cette page Web a été archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Allocution prononcée dans le cadre du Yukon Bench and Bar Seminar
Whitehorse (Yukon)
Le 10 septembre 2015
Allocution prononcée par Patricia Kosseim
Avocate générale principale et directrice générale, Direction des services juridiques, des politiques, de la recherche et de l’analyse des technologies
(Le texte prononcé fait foi)
Introduction
Vous vous souvenez peut-être du film policier américain Donnie Brasco, qui se déroule à New York dans les années 1970. Le film s’inspire de l’histoire vraie de l’agent d’infiltration Joseph Pistone, qui a infiltré une famille de mafiosi et qui endosse graduellement le rôle d’un criminel.
Dans une scène plus légère, un agent des services fédéraux d’écoute électronique demande à Brasco ce que signifie l’expression « Oublie ça ».
« "Oublie ça", explique Brasco, tu le dis si t’es d’accord avec un autre mec. Du genre, il dit "Raquel Welch, mais quelle femme… Oublie ça". »
« Ça se dit aussi quand t’es pas d’accord : "La Lincoln, c’est mieux que la Cadillac? Oublie ça ". »
« Et aussi pour indiquer ton plaisir: "Ah, bon sang, ces piments! Oublie ça". »
« C’est aussi un truc que tu peux dire à un mec pour l’envoyer paître. »
« Ou, "Oublie ça", peut aussi juste vouloir dire… "Oublie ça". »
Aujourd’hui, j’aimerais que nous nous demandions si l’on peut encore se contenter de dire « Oublie ça » à l’ère numérique, alors que les renseignements personnels sont publiés sur le Web à la vue de tous et pour toujours.
Le professeur Viktor Mayer-Schonberger, de l’Université d’Oxford, s’est posé cette question de façon plus sérieuse il y a six ans dans l’ouvrage intitulé Delete: The Virtue of Forgetting in the Digital Age. Il y décrit les profondes répercussions humaines et sociétales de la numérisation de masse et du stockage en ligne à bas prix, et la façon dont ils ont modifié notre comportement ordinaire : auparavant, on oubliait presque tout; aujourd’hui, on se souvient de tout.
C’est là un changement profond. Pensez :
- aux politiciens qui ont dû abandonner leurs aspirations politiques en raison d’un tweet déplacé qu’ils avaient publié des années avant de se porter candidats;
- aux gens qui ont perdu leur emploi à cause de vidéos en ligne où, pendant un week-end bien arrosé, ils avaient proféré des obscénités;
- aux professionnels qui ont perdu leur droit de pratique en raison d’un acte passé qui est revenu les hanter;
- aux jeunes adultes que tout le monde a accablés d’injures et de sarcasmes dans les médias sociaux après qu’ils eurent publié un message franchement idiot;
- plus tragiquement, aux adolescents victimes de cyberintimidation qui ont fait une dépression ou même, qui se sont suicidés après que d’autres eurent affiché des propos, des photos ou des vidéos cruels les concernant qui ne disparaitront tout simplement pas.
La vie privée, jadis protégée par le simple fait qu’il était difficile de trouver des renseignements ou de se les rappeler, ne bénéficie plus de ce voile d’obscurité. En tant que société, comment réagissons-nous à ce nouveau phénomène de la mémoire permanente, omniprésente et impitoyable?
Par le passé, le droit offrait des recours et traitait résolument en victimes les personnes visées par des déclarations diffamatoires publiées par d’autres. Plus récemment, de nouvelles infractions ont été ajoutées au droit criminel pour faire échec à la diffusion non autorisée d’images intimes et à la cyberintimidation.
Mais ces recours judiciaires ne s’appliquent pas dans toutes les situations — pensons, par exemple, au message malavisé, à la photo embarrassante ou au reportage qui, malgré sa véracité factuelle, ne semble plus pertinent.
Il n’est pas toujours envisageable de chercher à obtenir réparation lorsque l’information est diffusée à grande échelle sur le Web. C’est parfois même impossible lorsque les personnes qui affichent l’information — ou les sites Web qui la publient — n’ont pas enfreint la loi ou, pire encore, ont disparu dans la nature. C’est pourquoi on se tourne de plus en plus vers les intermédiaires, comme les moteurs de recherche, en raison du rôle déterminant qu’ils jouent en dirigeant le trafic Web vers le matériel en question.
L’arrêt Google Spain
Le cas qui a donné le ton à la tendance actuelle, pour ainsi dire, est l’arrêt rendu en mai 2014 dans Google Spain SL et Google Inc. c. AEPD et Mario Costeja González. Dans un arrêt clé contre Google, la Cour de justice de l’Union européenne a exigé que le moteur de recherche accède à la demande d’un avocat de supprimer les liens menant à de vieux articles de journaux concernant ses dettes, qu’il avait par ailleurs remboursées depuis longtemps. Les articles originaux demeureraient accessibles à partir du site Web des journaux, mais ils ne figureraient plus dans les résultats des recherches effectuées sur Google à partir du nom de l’avocat.
D’une certaine façon, cet arrêt semble attribuer aux moteurs de recherche la responsabilité de déterminer dans quels cas le droit d’un individu à la vie privée l’emporte sur l’intérêt du public à avoir accès à l’information, y compris lorsque les données issues de la recherche « apparaissent inadéquates, qu’elles ne sont pas ou plus pertinentes ou sont excessives eut regard aux objectifs recherchés et au temps qui s’est écoulé ».
Les personnes dont les demandes de délistage sont refusées peuvent porter plainte auprès d’autorités compétentes et responsables de la protection des données. Pour aider ces autorités à prendre les décisions difficiles, le groupe de travail « Article 29 », institué par la directive du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne relative à la protection des données, a publié des lignes directrices sur la mise en œuvre de l’arrêt Google Spain.
Le groupe de travail a établi une formule pour trouver un équilibre entre les intérêts d’un individu à protéger sa vie privée et l’intérêt du public à avoir accès à l’information en prenant en compte différents facteurs, par exemple :
- si la personne est une personne physique, si elle est connue du public ou s’il s’agit d’un mineur;
- si les données sont exactes, pertinentes, à jour et non excessives;
- si les renseignements personnels sont sensibles;
- si l’information cause un grave préjudice à la personne visée ou si elle la met en danger;
- le contexte dans lequel le matériel a été publié à l’origine — à des fins journalistiques, juridiques ou autres ou encore en lien avec un acte criminel.
Le groupe de travail a encouragé vivement les moteurs de recherche à publier leurs propres critères de délistage de l’information et à publier davantage de statistiques plus détaillées sur le sujet.
Et Google l’a fait. Au 30 août, l’entreprise avait reçu plus de 300 000 demandes et évalué plus d’un million d’adresses URL. Selon le journal The Guardian, plus de 95 % de ces demandes émanaient de monsieur et madame Tout-le-monde et moins de 5 %, de personnalités, de politiciens ou de criminels. Google a accepté de délister 42 % des adresses URL visées à la demande des personnes concernées.
Aux yeux de certains, l’arrêt de l’Union européenne représente une victoire pour la protection des renseignements personnels ou à tout le moins un progrès. En revanche, d’autres sont plus critiques. Jonathan Zittrain, professeur de droit à Harvard, l’a qualifié de « mauvaise solution à un problème très réel ».
D’après Jules Polonetsky, du groupe de réflexion américain Future of Privacy Forum, le fait de demander à Google de cesser de créer des liens menant à un contenu illégal est une chose. Mais que le tribunal renvoie à Google les décisions complexes et ponctuelles de publier ou de supprimer des renseignements est une erreur. Selon lui, en demandant à Google de faire office de tribunal de rois philosophes, la cour montre qu’elle ne comprend absolument pas les ramifications pratiques de cette question.
L’application de l’arrêt Google Spain à l’extérieur de l’Union européenne retient également l’attention. Dans une épreuve de force récente avec l’entreprise, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) de France a maintenu fermement que l’arrêt oblige les moteurs de recherche à supprimer les liens URL menant à tous les domaines et pas uniquement dans les pays de l’Union européenne. Selon elle, si l’information demeure accessible à partir de google.com ou de google.ca, on irait à l’encontre de l’objectif même du délistage de l’information et l’arrêt perdrait tout son sens.
D’après la position de Google, qui a été entérinée par son conseil consultatif d’experts indépendants, l’arrêt s’applique uniquement dans les pays d’Europe et ne vise pas à bloquer les adresses URL dans les recherches effectuées ailleurs de par le monde. Selon l’entreprise, aucune région ne devrait imposer ses valeurs et ses principes à d’autres États souverains susceptibles d’avoir des opinions différentes de ce qui constitue un juste équilibre.
En fait, plusieurs commentateurs ont fait vigoureusement valoir que l’équilibre dont il est question dans l’arrêt Google Spain ne tiendrait pas la route aux États-Unis, particulièrement à la lumière du premier amendement sur la liberté d’expression. Dans une chronique publiée dans le New Yorker, Jeffrey Toobin a décrit « l’anxiété ressentie vivement des deux côtés de l’Atlantique : en Europe, le droit à la vie privée l’emporte sur la liberté d’expression, tandis que c’est l’inverse aux États-Unis. »
Application dans le contexte canadien
Qu’en est-il au Canada?
Il n’y a pas encore de jurisprudence portant expressément sur ce point, mais quelques décisions rendues récemment en Colombie-Britannique nous donnent une bonne idée de la façon dont les tribunaux peuvent voir la responsabilité des moteurs de recherche lorsqu’il s’agit de supprimer des liens menant à des renseignements répréhensibles et jusqu’où ils iront pour leur ordonner de le faire selon les circonstances.
L’affaire Niemela c. Malamas découle d’une poursuite en diffamation intentée par un avocat contre un de ses anciens clients. Le plaignant a demandé une injonction afin que le tribunal ordonne à Google, qui n’était pas partie à la poursuite, de n’afficher aucun lien menant à des commentaires diffamatoires dans ses résultats de recherche dans le monde entier — pour les adresses URL et les extraits connexes aussi appelés « snippets ».
Google avait volontairement désindexé les adresses URL menant au matériel diffamatoire à partir de son site Web google.ca, mais elle avait refusé d’en faire davantage comme le demandait l’avocat.
Comme le plaignant exerçait à Vancouver, la grande majorité de ses clients étaient canadiens et plus de 90 % des recherches portant sur son nom étaient faites à partir d’adresses IP canadiennes.
Le juge Fenlon, de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, a conclu que les efforts volontaires déployés jusque-là par Google suffisaient à empêcher les gens du Canada d’avoir accès aux sites Web en cause. Selon lui, on ne pouvait pas prouver hors de tout doute que le plaignant serait lésé par la décision de ne pas accorder une injonction à l’échelle mondiale.
Fait intéressant, le juge a pris en compte un autre facteur, soit le fait que Google ne pourrait sans doute pas se conformer à une ordonnance à l’échelle mondiale, puisque la loi américaine lui interdit de bloquer les résultats de recherche et qu’elle contreviendrait par le fait même au premier amendement sur la liberté d’expression.
L’avocat plaignant a également intenté une poursuite contre Google elle-même, pour le rôle qu’elle avait joué en affichant des liens et des extraits menant les utilisateurs vers les pages Web renfermant le contenu diffamatoire. Cette poursuite distincte reposait sur plusieurs allégations dont Google a demandé le rejet par procédure sommaire.
En ce qui concerne l’allégation d’atteinte à la vie privée sous le régime de la loi sur la protection de la vie privée de la Colombie-Britannique, le tribunal a affirmé que, dans ce cas particulier, le plaignant ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce que ses renseignements personnels soient protégés puisqu’ils relèvent de l’exercice de ses fonctions professionnelles. Selon le juge Fenlon, M. Niemela n’alléguait pas que les articles décrivaient un aspect de sa vie qui devrait selon lui demeurer confidentiel et à l’abri du public, mais qu’il s’agissait plutôt de descriptions peu flatteuses et erronées de son rendement professionnel.
Le tribunal a rejeté l’allégation de diffamation du plaignant contre Google, qu’on accusait d’avoir publié des extraits dans ses résultats de recherche. S’inspirant ainsi du raisonnement de la Cour suprême dans Crookes c. Newton et d’un point d’une récente jurisprudence anglaise, il a statué que Google était un instrument passif et non celui qui avait publié les extraits.
Il est intéressant de comparer cet arrêt avec un arrêt antérieur rendu par le juge Fenlon et maintenu par la Cour d’appel dans Equustek Solutions Inc. c. Jack. Cette cause portait sur une demande d’injonction similaire visant à forcer Google à cesser d’afficher des adresses URL associées à certains sites Web dans ses résultats de recherche dans le monde entier.
Les procédures sous-jacentes dans cette affaire avaient été intentées contre un intimé dont on avait perdu toute trace dans une affaire de contrefaçon de marque et d’appropriation illicite de secrets commerciaux. Refusant de se conformer à plusieurs ordonnances du tribunal, l’intimé a mis fin à ses activités à Vancouver, tout en continuant d’annoncer et de vendre des produits de contrefaçon par l’intermédiaire de nombreux sites Web « clandestins ».
Google avait offert de supprimer les liens menant à des pages précises à partir de résultats de recherches dans google.ca, mais chaque fois qu’elle le faisait, l’intimé déplaçait simplement le contenu répréhensible vers une nouvelle page Web. Il s’agissait selon les plaignants d’un jeu de chat et de souris perpétuel.
Les plaignants ont demandé à Google de bloquer tous les sites Web de l’intimé dans ses résultats de recherche dans le monde entier, mais Google a refusé d’aller aussi loin.
Reconnaissant qu’il ne fallait pas rendre à la légère une ordonnance de portée internationale, à plus forte raison si une ordonnance de portée nationale suffisait pour prévenir tout préjudice, la Cour d’appel a maintenu la décision du juge Fenlon selon laquelle, dans ce cas précis, une ordonnance se limitant aux résultats de recherche dans google.ca ne serait pas efficace compte tenu de tous les moyens détournés utilisés par l’intimé. Le tribunal a maintenu l’ordonnance internationale contre Google.
Il est intéressant de noter le contexte ayant mené à cette décision. Après avoir dûment pris en compte la compétence en matière personnelle et les principes de courtoisie internationale, qui avaient amené le juge Fenlon à affirmer la compétence territoriale sur la question, la Cour d’appel a convenu qu’il n’était pas réaliste d’affirmer que l’ordonnance rendue par le juge pouvait heurter la sensibilité d’autres pays.
Quant à la possibilité que les intimés puissent souhaiter utiliser leurs sites Web pour s’exprimer de façon légitime plutôt que pour s’adonner à des activités de marketing illicites, la Cour d’appel a affirmé qu’elle était purement hypothétique. Cependant, si c’était le cas, l’intimé pourrait demander une modification de l’ordonnance en invoquant la liberté d’expression.
Il reste à voir comment un tribunal statuerait sur des allégations d’atteinte à la vie privée contre des intermédiaires Web dans des circonstances différentes. Toutefois, d’après ce que montrent ces deux affaires à ce jour, un tribunal sera sensible à la nature du matériel en cause et à la mesure dans laquelle il entrave la liberté d’expression — ici et ailleurs dans le monde. Ces dossiers montrent également que les tribunaux, tout en étant conscients de la nature globale du Web, exigeront des preuves concrètes de l’insuffisance d’une ordonnance nationale avant d’ordonner aux moteurs de recherche d’aller plus loin.
Analyse
Dans des commentaires publics, on a comparé Google à la plus grande bibliothèque du monde. Certains ont affirmé qu’aucune personne raisonnable ne s’attendrait à ce que les bibliothécaires censurent et détruisent les livres dans une société libre et démocratique. Et à ce jour, personne ne demande avec insistance que tout le matériel original soit retiré du Web.
Mais une personne raisonnable s’attendrait-elle à ce que le bibliothécaire recueille et répertorie tout ce que nous avons écrit et tout ce que d’autres ont écrit à notre sujet — y compris le matériel inédit, jamais approuvé par les avocats, d’un éditeur ou par des pairs examinateurs? S’attendrait-elle à ce que l’information soit organisée soigneusement sur une tablette ou une étagère, étiquetée par nom et accessible en tout temps au monde entier?
Certes, Google est particulièrement sous le feu des projecteurs parce qu’il s’agit du moteur de recherche le plus puissant au monde et qu’il est utilisé pour près de 75 % des recherches sur le Web. Mais il n’est pas le seul participant au débat sur le droit à l’oubli.
Plusieurs exploitants de sites Web se sont eux aussi autoproclamés bibliothécaires, parfois pour des motifs douteux. L’entreprise Global24h est un exemple intéressant à ce chapitre.
Globe24h est un site Web basé en Roumanie qui republie des décisions de cours et de tribunaux — y compris les cours et tribunaux canadiens. Contrairement aux sites Web de nature juridique comme CanLII, qui appliquent une norme d’exclusion utilisant des « robots Web » pour restreindre l’indexation des décisions par nom et réduire ainsi l’incidence sur la vie privée des individus, le site Globe24h est indexé de façon à ce que l’on puisse y effectuer des recherches par nom de personne.
Globe24h affirme vouloir rendre l’information juridique accessible gratuitement sur le Web. Or, à l’issue d’une enquête menée au cours de la dernière année, le Commissariat a constaté que le site Web tirait des revenus de publicités et imposait des frais aux personnes souhaitant que leurs renseignements personnels soient retirés du site.
Le Commissariat a conclu que les fins visées par Globe24h en republiant les décisions des cours et des tribunaux canadiens par nom de personne et en imposant des frais pour supprimer les renseignements personnels de personnes concernées n’étaient pas des fins qu’une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances. L’information était publiée à l’origine dans des répertoires juridiques canadiens, mais elle n’a pas été rendue publique pour les fins auxquelles Globe24h l’utilisait et l’entreprise n’avait pas obtenu le consentement des personnes pour l’utiliser à des fins différentes.
Le Commissariat a donc recommandé que Globe24h efface de ses serveurs les décisions de cours et de tribunaux canadiens qui contiennent des renseignements personnels pouvant être recherchés par nom. Malheureusement, l’entreprise a refusé de mettre en œuvre cette recommandation et l’une des personnes ayant porté plainte au Commissariat a depuis présenté une requête contre elle devant la Cour fédérale.
Nous examinons actuellement les mesures à prendre dans cette affaire, entre autres les options de poursuites judiciaires. Dans l’intervalle, nous avons pris d’autres mesures pratiques afin de réduire les préjudices éventuels pour les individus. Nous avons communiqué avec les principaux moteurs de recherche pour leur demander de supprimer volontairement les liens menant au site Web de Globe24h ou à tout le moins de réduire la visibilité de l’entreprise dans les résultats de recherche. Nos efforts sur ce front commencent à porter leurs fruits.
Solutions possibles
Cet exemple m’amène à enchaîner avec une analyse plus générale des solutions envisagées dans le débat actuel sur le droit à l’oubli.
Solutions législatives
Les initiatives législatives comptent parmi les solutions possibles. Plusieurs pays ont récemment adopté des lois sur le droit à l’oubli, entre autres l’Espagne, l’Allemagne, l’Islande, la Norvège, le Liechtenstein, la Suisse et, dernièrement, la Russie, dont la loi entrera en vigueur au début de 2016.
En vertu de la nouvelle loi sur les enfants mineurs et le monde numérique adoptée en Californie — intitulée Privacy Rights for California Minors in the Digital World et communément appelée « loi à effacer » —, un jeune peut maintenant demander que l’on supprime tout renseignement personnel le concernant qu’il a publié en ligne.
Au Canada, une loi néo-écossaise et une loi fédérale ont été adoptées contre la cyberintimidation. Selon ces lois, la publication d’images intimes en ligne sans le consentement des personnes concernées constitue une infraction.
Solutions pratiques
On a également élaboré des solutions pratiques pour répondre aux demandes de retrait d’information sur le Web.
Plusieurs moteurs de recherche et sites de médias sociaux se sont volontairement dotés de mécanismes pour délister ou supprimer le contenu illégal, par exemple celui qui contrevient au droit d’auteur, l’information diffamatoire, les données financières volées et la pornographie de vengeance.
Le mode de fonctionnement de ces mécanismes dans la pratique et leur portée posent certaines difficultés.
Par exemple, le Commissariat a mené à bien en 2013 une enquête visant l’usurpation en ligne de l’identité d’une adolescente. Après avoir confirmé que le profil Facebook en cause était effectivement faux, Facebook a supprimé le compte. Toutefois, malgré la demande de la mère, Facebook n’est pas allée jusqu’à informer tous les amis de l’imposteur de la tromperie. Le compte avait été supprimé, mais Facebook considérait de façon générale que la notification pourrait stigmatiser de nouveau l’adolescente, ce qui n’était pas souhaitable. Selon l’entreprise, il ne serait ni approprié, ni pratique, ni avantageux que Facebook intervienne dans les relations interpersonnelles des gens.
Néanmoins, à l’issue de consultations avec le Commissariat, l’entreprise a décidé d’autoriser une procédure selon laquelle, lorsque la situation s’y prête, une personne n’ayant pas de compte Facebook – comme l’adolescente dans ce cas précis — pourrait envoyer un avis en son propre nom.
Selon un autre exemple, à l’instar d’autres médias sociaux, Twitter permet aux utilisateurs de supprimer eux-mêmes leurs messages. Jusqu’à récemment, un réseau de sites tiers appelé « Politwoops », exploité par la Open State Foundation dans plus de 30 pays, avait conclu avec Twitter une entente lui donnant accès à l’interface du programme d’application de Twitter pour rétablir des tweets supprimés par des politiciens.
À la fin d’août, Twitter annonçait qu’il mettait fin à l’entente conclue avec Politwoops Canada (comme il l’avait fait en mai pour le pendant américain de Politwoops). En d’autres termes, Twitter traiterait dorénavant tous ses abonnés de la même façon.
Ce changement a suscité un débat dans les médias concernant, d’une part, le respect du droit des individus à s’exprimer librement sans craindre que leurs propos soient immuables et irrévocables et, d’autre part, la conservation des propos des politiciens en tant qu’information du domaine public dont ils doivent assumer la responsabilité et à laquelle le public devrait avoir un droit d’accès.
Solutions technologiques
Tout comme les solutions juridiques et pratiques, les solutions technologiques contribuent à faire avancer les choses.
Prenons l’exemple des protocoles d’exclusion des « robots Web » dont j’ai parlé un peu plus tôt. Ces protocoles ont été adoptés par les cours de justice et les tribunaux administratifs ainsi que par les sites Web juridiques comme CanLII.
Au fil du temps, on a créé et perfectionné des technologies de brouillage, par exemple pour permettre aux gens photographiés par les véhicules de Google Streetview de demander que leur photo soit brouillée pour éviter que l’on puisse les reconnaître sur les images et les cartes des rues publiées par l’entreprise. Les médias du Royaume-Uni ont également commencé à brouiller le visage des enfants.
Victor Mayer-Schonberger, entre autres, s’est penché sur le concept de l’écologie de l’information, selon lequel le contenu affiché sur le Web serait assorti d’une date de péremption et supprimé d’office le moment venu.
La réputation et la protection de la vie privée figurent au nombre des priorités stratégiques du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada pour les prochaines années. Pour aider à faire progresser le débat, nous publierons plus tard cette année un document de discussion qui constituera le point de départ d’un processus d’appel de propositions sur les solutions possibles — y compris des solutions technologiques novatrices. À la lumière des propositions reçues, nous espérons élaborer une position de principe sur le droit à l’oubli dans le contexte canadien.
Conclusion
En terminant, j’aimerais vous faire part de deux histoires émouvantes qui illustrent clairement la nécessité d’établir une marche à suivre.
Dans une chronique publiée dans le New Yorker intitulée « The Solace of Oblivion », Jeffrey Toobin a raconté la triste histoire d’une famille qui avait vu circuler sur le Web des images lugubres de leur fille ayant perdu la vie dans un accident de la route. Des employés de la California Highway Patrol avaient publié les photos en question à l’occasion de l’Halloween, simplement pour créer un effet traumatisant. Les parents ont tenté en vain de faire retirer les photos.
Google a refusé de délister les liens menant aux photos choquantes et la famille n’avait aux États-Unis aucun recours juridique pour forcer l’entreprise à le faire. La famille a tenté de négocier avec la patrouille routière pour faire transférer la propriété des photos et pouvoir ainsi faire valoir son droit d’auteur de manière à forcer Google à les retirer. Là encore, ces efforts se sont révélé un coup d’épée dans l’eau.
La meilleure chose que la famille pouvait faire, c’était de payer pour retenir les services de l’entreprise Reputation.com. À défaut de supprimer complètement les liens, ce que cette entreprise ne peut pas faire, l’entreprise manipule les recherches effectuées à l’aide de Google de façon à repousser aussi loin que possible les résultats de recherche indésirables, offrant ainsi un soulagement partiel à ceux qui ont les moyens de se payer ce service.
Au cours d’une conférence TED Talk tenue récemment, Monica Lewinsky a mis fin aux décennies de silence qu’elle s’était imposées pour parler de son expérience en tant que « patiente zéro de l’ère numérique ». Les nouvelles concernant sa liaison avec le président des États-Unis, de même que toutes les moqueries et tous les commentaires salaces sur sa personne, se sont propagés comme une traînée de poudre à l’échelle mondiale, principalement par courriels à une époque où ceux-ci commençaient à devenir un outil de communication à grande échelle.
Lorsqu’on examine ce cas en fonction des critères établis par la Cour de justice européenne ou des lignes directrices du groupe de travail « Article 29 », toute demande de retrait que Mme Lewinsky aurait pu présenter à l’époque aurait certainement été refusée en bloc et de façon universelle. Après tout, il s’agissait d’une histoire qui a presque fait tomber le président du pays le plus puissant au monde.
Mais cette conclusion judiciaire, quoique parfaitement rationnelle, semble froide et insatisfaisante lorsqu’on entend Monica Lewinsky décrire les répercussions pénibles et permanentes de cette erreur qu’elle a commise alors que, jeune stagiaire, elle est tombée en amour avec son patron.
N’y a-t-il pas, demande-t-elle, une place pour la compassion sociale ou une convention régissant le comportement éthique sur le Web?
Monica Lewinsky n’est pas seule. Le président Obama a demandé qu’on adopte une déclaration du droit des individus à la vie privée à l’ère numérique. Récemment, Joseph Cannataci, premier rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à la vie privée, a réclamé publiquement l’adoption d’une convention similaire à la Convention de Genève pour protéger les données sur le Web.
L’an dernier, au cours de la Conférence annuelle de l’Association du Barreau canadien, j’ai fait partie d’un groupe d’experts à qui l’on a demandé de déterminer si le moment était venu d’adopter une déclaration des droits pour l’ère numérique, comme l’a proposé Tim Berners-Lee, inventeur du Web.
Les étoiles sont peut-être bien alignées. Le moment est peut-être venu de conclure un pacte social universel concernant le monde en ligne dans lequel nous voulons vivre et voir vivre nos enfants aujourd’hui et demain.
En tant que membre de l’appareil judiciaire et du Barreau, vous jouerez un rôle de premier plan pour aider à concevoir et à élaborer un tel pacte.
Je vous remercie.
- Date de modification :